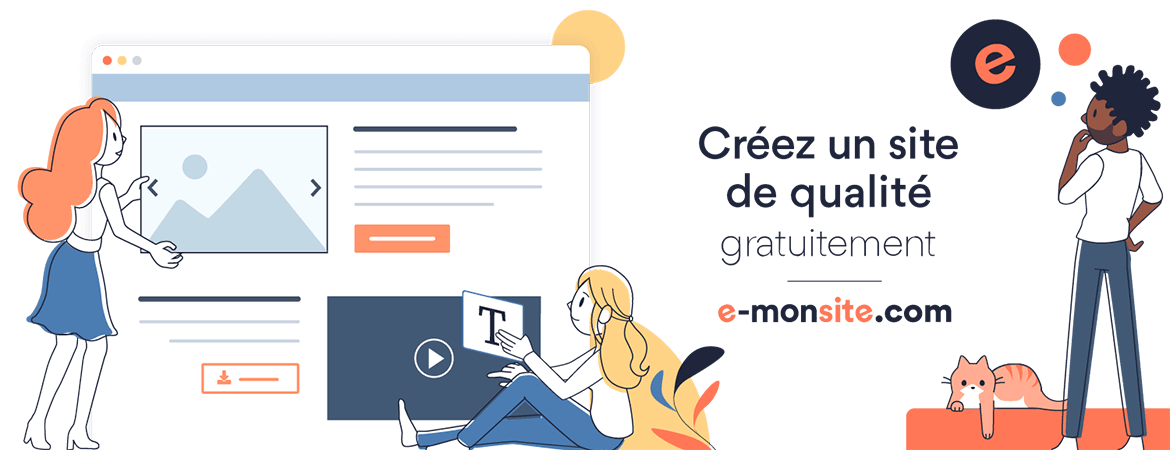Surdité et langue des signes : analyseurs politiques, philosophiques et
sociolinguistiques. VIII. Mobilisations collectives des sourds : le mouvement silencieux
- Andrea Benvenuto, chargée de cours à l'Université Paris-8/Vincennes-Saint-Denis
- Marie Coutant, ingénieure d'études à l'EHESS
- Alexis Karacostas, practicien hospitalier, psychiatre
- Didier Séguillon, maître de conférences à l'Université Paris-Ouest Nanterre-La-Défense (Paris-X)
S'il s'agit de l'enseignement principal d'un enseignant, le nom de celui-ci est indiqué en gras.
1er et 3e lundis du mois de 19 h à 21 h (salle M. & D. Lombard, 96 bd Raspail 75006 Paris), du 4 novembre 2013 au 2 juin 2014
Le programme des deux dernières années a eu pour objectif d'étudier d'une part, les conditions politiques, historiques et philosophiques d’émergence et d’installation du projet pédagogique et anthropologique de l’abbé de l’Épée (1712-1789), d'autre part, d'analyser les évolutions de la médecine de la surdité et de la place de la langue des signes dans la pédagogie des sourds au XIXe siècle. D'opérateur épistémologique interrogeant les fondements du langage, en un siècle la surdité est devenue une question d'ordre pathologique. Le croisement qui se produit entre médecine et éducation dans les institutions de sourds au XIXe siècle a rendu le traitement de la surdité indissociable du processus de subjectivation des sourds. Le pédagogue, le sourd et le médecin n’ont été ni totalement assujettis à la norme médicale réparatrice de la surdité, ni entièrement étrangers à son ascension. À des degrés divers, chacun a contribué à l’édifier et chacun a pu s’y opposer. Nous avons ainsi terminé l'année en montrant l'émergence des premières formes de résistance et d’organisation collective des sourds qui, par la revendication du droit à l'intelligence et à la parole des signes, font irruption dans l'espace public et politique avec une singularité propre. D’enfants éducables que la nation prend en charge, les sourds deviennent des acteurs politiques avec une parole et des modes d'organisation propres. L’institution des banquets annuels de sourds-muets (qui célèbrent au mois de novembre la naissance de l'abbé de l'Épée, presque sans interruption depuis 178 années) et la création en 1838 de la première association de sourds au monde, c’est-à-dire de personnes qu’on nommerait aujourd’hui handicapées, préfigurent les mobilisations identitaires contemporaines. Le programme du séminaire de cette année sera consacré à l’étude de l'histoire et particulièrement de l'histoire politique des mobilisations collectives des sourds. Nous aborderons cette histoire par l'analyse du mouvement des sourds dit « silencieux ». Ce mouvement, qui a pu revêtir des formes aussi diverses que les associations silencieuses de tous ordres, la presse silencieuse, les salons des artistes silencieux ou le sport silencieux, fait suite au mouvement sourd des premières décennies du XIXe siècle. À partir d'un corpus d’archives pratiquement inexploré, nous étudierons particulièrement deux périodes : la première s’étend de la participation des artistes silencieux à l'Exposition Universelle de Paris de 1889 avec la mise en place du Cercle des sourds-muets de Paris, espace spécifiquement sourd créé pour accueillir les sourds de province et de l’étranger, à l’ouverture du foyer des sourds en 1924 et la tenue à Paris des premiers Jeux olympiques des sourds, impulsés par Eugène Rubens-Alcais ; la seconde s’étendra jusqu’en 1975 qui voit l'émergence de ce qu’il est convenu d'appeler le « Réveil Sourd ». S’ouvre ainsi un vaste chantier qui se poursuivra l'année prochaine et qui vise, au delà de la démarche historique, à interroger les formes contemporaines du politique dans une perspective distincte de celle de l'assignation des identités et de leurs formes d'objectivation institutionnalisée.
Suivi et validation pour le master : Bi/mensuel annuel (24 h = 6 ECTS)
Renseignements : par courriel.
Direction de travaux d'étudiants : sur rendez-vous uniquement.
Réception : sur rendez-vous par courriel.
Niveau requis : ouvert à tous.
Adresse(s) électronique(s) de contact : Andrea.Benvenuto@ehess.fr, Marie.Coutant@ehess.fr